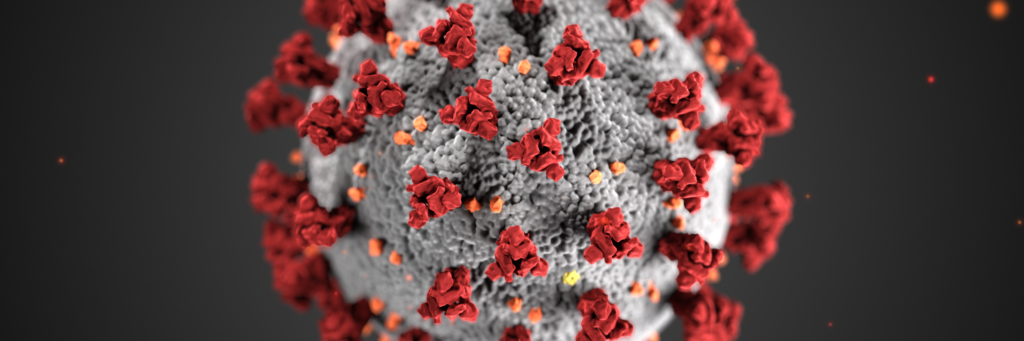La pandémie de COVID 19 s’étend inexorablement à travers le monde. Plus de la moitié de l’humanité vit confinée et les décès se comptent par dizaine de milliers. Une profonde récession mondiale se profile, dont nous savons d’ores et déjà que les conséquences se feront ressentir sur la décennie à venir – au moins. Nous ne saurions nous contenter d’une explication qui voudrait en réduire l’origine au pangolin ou à la chauve-souris, à un simple hasard de l’évolution. Cette crise trouve ses racines profondes dans les logiques propres à un mode de production qui détruit la planète et pille ses ressources, un mode de production qui influence les deux variables de l’équation d’une catastrophe : il augmente à la fois le risque de phénomène naturel extrême et la vulnérabilité de millions de personnes à ces phénomènes.
Par Boris Campos, PCF Lorient
- Le prix de la casse des services publics, en particulier du système de santé publique et de la recherche
La population et la précarité augmentent et, avec elles, le nombre de personnes souffrant de maladies chroniques et de ses complications. La charge de travail augmente en conséquence. Pourtant, quelles ont été les décisions des gouvernements qui se sont succédés ? L’austérité. Les coupes budgétaires se sont succédées et avec elles, les suppressions de postes et de lits hospitaliers. Dans les suites de la crise de 2008, les gouvernements ont imposé en dix ans 8 milliards d’euros d’économies et, pour 2020, il fallait encore en réaliser 600 millions. En 20 ans, 100 000 lits hospitaliers ont été supprimés. En 1980, il y avait 11 lits d’hôpital pour 1000 habitants. On n’en compte plus que 6. Le mode de gestion des établissements de santé a été calqué sur celui des entreprises capitalistes. Il faut rendre le soins “efficient”, produire au moindre coût. Les nouvelles méthodes de management font subir une pression sur les professionnel.le.s de santé, qui doivent travailler dans des conditions de travail de plus en plus dégradées. Cela ne s’est pas fait sans résistance. Pour ne parler que de la période récente, la crise sanitaire a été précédé par 11 mois de lutte dans le secteur, mobilisant toutes les catégories du personnel des établissements de santé, avec des actions inédites, comme les démissions collectives de médecins dans des commissions hospitalières. Ce mouvement était bien plus qu’une alerte : c’était un cri de rage et de désespoir contre ceux qui mènent tambour battant les politiques austéritaires. Nous ne pouvons pas dire qu’au cours de cette crise les professionnel.le.s de santé se sacrifient : ils ont été sacrifié.e.s
La recherche publique, en particulier la recherche fondamentale, a aussi fait les frais de l’austérité. Précarité des professionnels et des programmes, pilotage par la performance favorisant la quantité à la qualité, partenariat “public-privé” au détriment du public, etc : le secteur était lui aussi mobilisé depuis plusieurs mois. L’action du 5 mars 2020 “l’université et la recherche s’arrête” devait être un point d’orgue avant des actions plus dures. La recherche fondamentale, peu rentable à court terme, est pourtant essentielle pour ne pas être pris au dépourvu face à l’émergence d’un nouveau microbe. Face à une situation d’urgence, la science commence évidemment par se baser sur les connaissances déjà acquises. Partant de là, “la seule solution, c’est l’anticipation”, comme le rappelle un virologue du CNRS. “En 2015, avec des collègues belges et hollandais, nous avions envoyé deux lettres d’intention à la Commission européenne. Nous avions ciblé neuf familles de virus émergents à étudier de manière fondamentale.” La Commission européenne n’a pas cru bon d’octroyer à leurs équipes les financements demandés. “Depuis, deux ont fait l’objet d’épidémies : le coronavirus et le Zika.” Sans vision sur le long terme, les financements varient aux grès de l’actualité. “Désormais, quand un virus émerge, on demande aux chercheur·ses de se mobiliser en urgence et de trouver une solution pour le lendemain.” Une fois l’épidémie éteinte, ce n’est qu’une question d’année avant que les financements reviennent à leur niveau précédent la crise.
Ainsi, nous devons faire face à la situation avec une moindre capacité de soins et armé de moins de connaissance. L’obsession de la “maîtrise des dépenses publiques”, c’est à dire la destruction méthodique de nos services publics, nous a rendu plus vulnérable. Pour le dire en quelques mots : l’austérité tue.
- Profit et fragmentation internationale des chaînes de production
La capacité productive de la France a considérablement chuté au cours des dernières décennies. Elle importe tout ou partie de nombreux produits essentiels. En interrompant la “chaîne de valeur” de nombreuses marchandises, la crise actuelle expose les pays importateurs de ces marchandises à un défaut d’approvisionnement.
L’un des 10 pays les plus riches au monde, la France, fait face à une pénuries de produits vitaux en termes de santé publique. Il y manque du matériel de protections individuelles les plus basiques, non seulement pour la population mais aussi pour les soignant.e.s en première ligne ! Pour masquer la pénurie et son manque d’anticipation, le gouvernement déballe un argumentaire grotesque. Soyons clairs : les recommandations actuellement en vigueur pour le port de masque sont dictés par la pénurie et non pas par des raisons de santé publique. L’intérêt d’une utilisation massive du masque n’est plus à démontrer*. Comment expliquer ce dénuement ? La France avait jusqu’à récemment une capacité de production de 8 millions de masques hebdomadaires quand il en faudrait au moins, de l’aveu même du gouvernement, 40 millions par semaine. Dans le secteur de la santé comme dans n’importe quel autre, la logique capitaliste agit de manière implacable : pour maximiser les profits, il faut diminuer les coûts de production. Cela conduit à délocaliser les activités gourmandes en main d’oeuvre dans les pays où elle est peu coûteuse. A titre d’exemple, nous recommandons la lecture du témoignage d’un ancien directeur d’une usine bretonne fabricant de masques. La production s’étant concentrée en Chine, l’usine a fermé ses portes en 2018. Le groupe américain Honeywell, dernier propriétaire en date, a revendu les lignes de productions partiellement financées par l’Etat à la découpe, à des ferrailleurs. La recherche de profit pousse parfois les capitalistes à détruire purement et simplement l’outil de travail !
De même que le port du masque, la stratégie de ne dépister que les cas graves n’a jamais été dictée par des considérations de santé publique. L’OMS recommande depuis le début de l’épidémie une stratégie de dépistage massif. Ce n’est pas non plus un problème de capacité technologique : la technique nécessaire, la PCR, est de nos jours d’utilisation courante. Si les capacités des laboratoires hospitaliers et de ville venaient à être insuffisantes, il resterait la possibilité de réquisitionner les laboratoires de recherche ou de certains laboratoires vétérinaires. Non, rien de tout cela : le problème principal pour envisager une stratégie de dépistage massif est le manque de disponibilité de ces tests de dépistage, qui doivent être commandés à l’étranger**. Une telle stratégie est pourtant nécessaire pour rompre efficacement les chaînes de transmission -et réduire ainsi la mortalité.
Pour ce qui est de la pharmacopée, le problème vient aussi de notre dépendance à la production extérieure. Selon l’inspection générale des affaires sociales, la proportion des principes actifs issus d’un pays hors de l’Union européenne est passée de 20% à 60 voire 80% en l’espace de 30 ans. Ils sont maintenant essentiellement produits en Chine et en Inde, où les coûts de production sont moindres. Les interruptions des chaînes de production ont donc également des effets sur la disponibilité de traitements de premières nécessités. Comme en témoigne un réanimateur francilien dans Mediapart fin mars, l’hôpital fait face à une pénurie de sédatifs nécessaires en réanimation ou encore d’antibiotiques les plus courants, comme l’augmentin, utile dans le traitement des infections pulmonaires. « Nous sauvons la vie des patients Covid les plus critiques en les endormant profondément, et en les faisant respirer grâce à des machines, explique-t-il. Pour cela, on a recours à des médicaments anesthésiques puissants, notamment le curare, pour que l’organisme oppose le moins de résistance possible. Ce sont des médicaments quotidiens, anciens, de première nécessité. Dans mon hôpital, nous avons trois jours de stock. Pour s’en sortir, on fait appel à la débrouille, on appelle des collègues pour trouver des lots ici et là. Et on réfléchit à avoir recours à d’autres médicaments, parfois abandonnés depuis longtemps. On s’éloigne des standards de soins, à l’aveugle. C’est vrai, on doit choisir les patients admis dans notre service, en fonction de leur probabilité de s’en sortir.» Devoir décider de donner une chance de survie ou non : voilà où en sont réduites les équipes de soins faute d’approvisionnement !
Les pénuries ont contribué à augmenter la mortalité au cours de cette pandémie. Elles s’expliquent par la désindustrialisation du pays qui elle-même s’explique par la recherche du coût de la force de travail le plus bas possible. Les pénuries mettent en lumière l’absence de politique industrielle digne de ce nom : la planification de la production en fonction des besoins de la population.
- Les absurdités d’une économie basée sur la concurrence exacerbées par la crise
La question de la pénurie de tests de dépistage permet d’illustrer un autre problème que l’éclatement des chaînes de production : au nom du secret des affaires, la composition exacte du réactif est inconnue. Quant bien même le gouvernement souhaiterait lancer une ligne de production française, il n’y aurait pas accès. Qu’importe qu’il s’agisse d’un enjeu majeur de santé publique : sa diffusion est restreinte par le droit de propriété. Dans une économie de marché, ce droit de propriété est essentiel pour garantir les profits. Il permet entre autres de fixer un prix, et celui des marchandises menacées de pénuries explose. Le coût de production d’un kit de dépistage est estimé à 12 euros ? Son prix de vente en France à été fixé à 112 euros.
Pour pouvoir faire de cette crise une “opportunité” (c’est à dire l’enrichissement de quelques individus sur des problématiques de santé collective), les entreprises se livrent une féroce compétition. Il faut être la première à déposer un brevet, la première à proposer un traitement ou un vaccin sur le marché. Le discours dominant répand la propagande de la compétition pour le profit qui créerait de l’émulation, source d’innovation. Mais la compétition pousse au secret, et le secret freine la coopération et, par définition, le partage d’informations scientifiques. Au final, le traitement mettra plus de temps à être disponible et il reviendra plus cher à la collectivité -puisque les actionnaires se serviront grassement au passage.
La gestion de la crise pâtit aussi de la concurrence entre les nations elles-mêmes -et en leur sein, entre les régions. Selon les règles de l’offre et de la demande, l’achat de matériel se fait aux plus offrant. Les masques sont vendus à prix d’or et donnent lieu à des enchères sauvages, jusqu’à trouver nouvel acquéreur sur le tarmac. Les autorités françaises se plient aux règles économiques qui régissent les échanges entre nations civilisées au XXIè siècle. C’est pourquoi dans ce vaste marché mondial garant d’un monde de paix et de prospérité, elles s’adonnent elles aussi au détournement de matériel, comme celui initialement commandé par la Suède. Un tel niveau de spéculation est aussi la porte ouverte à tous les trafics et contrefaçons.
Autre conséquence et non des moindres : la concurrence pousse les entreprises à poursuivre leur activité, y compris au détriment de la santé de leurs salariés. De la petite station de ski qui tarde à fermer et qui devient un foyer de transmission international à Amazon*** qui refuse de prendre les mesures qui s’imposent (sans que les pouvoirs publics ne cherchent à lui imposer quoi que ce soit), les exemples sont légions. Malgré le confinement, le virus a pu bénéficier pour se diffuser de la poursuite d’activités non essentielles mais lucratives.
Quand il faudra éponger les dettes publiques, c’est au nom de la “compétitivité” qu’on cherchera à nous imposer de travailler plus pour gagner moins. Augmentation du temps de travail, réduction du nombre de jours fériés et de RTT : le MEDEF est déjà sur le coup. Nous avons toutes les raisons de rejeter un système qui érige la compétition en modèle pour l’humanité. C’est la proposition des communistes : poser les bases d’une société solidaire, produisant en fonction de l’intérêt collectif. Cela suppose de soumettre l’économie au contrôle démocratique de la population. Pour atteindre ce but, notre classe devra se battre pour conquérir le droit de propriété sur les outils de production.
13/04/20
* Pour ne citer que 2 articles de revues scientifiques de référence internationale :
« Respiratory virus shedding in exhaled breath and … – Nature. » 3 avr.. 2020, https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2. Date de consultation : 11 avr.. 2020.
« Face masks for the public during the covid-19 crisis | The BMJ. » 9 avr.. 2020, https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1435. Date de consultation : 11 avr.. 2020.
** Y compris si l’entreprise est française : Biomérieux produit ses nouveaux tests au Etats Unis !
*** Mention spéciale pour Amazon qui depuis des années échappe à l’impôt par “l’optimisation fiscale” : aujourd’hui, elle fait partie des entreprises qui tire le plus grand profit de cette crise. Pendant ce temps les hôpitaux sont mis à genoux, sous financés… notamment faute de recette fiscale !