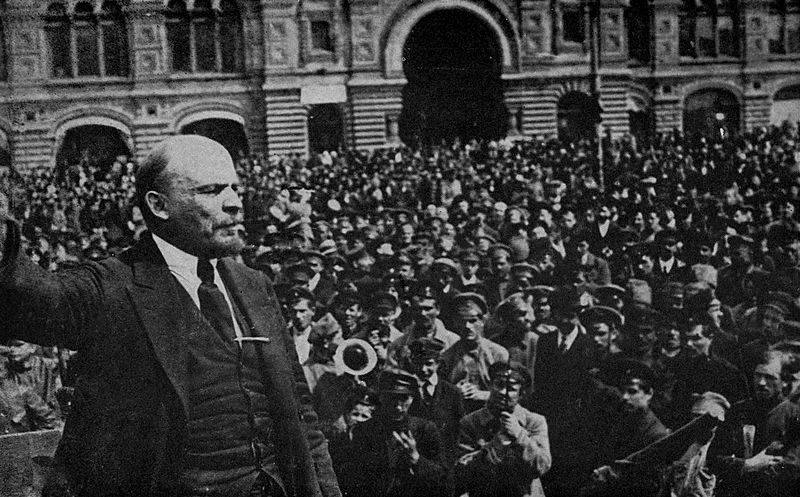Ces dernières années, les grèves ouvrières sont devenues extrêmement fréquentes en Russie. Il n’est pas de province industrielle, désormais, où il ne s’en soit produit plusieurs. Dans les grandes villes elles éclatent sans discontinuer. On conçoit donc que les ouvriers conscients aussi bien que les socialistes se demandent de plus en plus souvent quelle est la signification des grèves, comment les conduire et quelles sont les tâches des socialistes qui participent à ces grèves.
Nous voulons essayer d’exposer quelques-unes de nos idées sur ces questions. Dans un premier article, nous nous proposons d’étudier la signification des grèves dans le mouvement ouvrier en général ; dans un deuxième, nous parlerons des lois russes contre les grèves et, dans un troisième, nous dirons comment les grèves ont été et sont conduites en Russie et quelle doit être l’attitude des ouvriers conscients à leur égard [1].
***
Il faut tout d’abord se poser une question :
comment s’expliquent l’apparition des grèves et leur extension ?
Quiconque se remémore tous les cas de grèves qu’il peut connaître
par son expérience personnelle, par les récits d’autres personnes
ou par les journaux, constatera d’emblée que les grèves apparaissent
et s’étendent là où apparaissent et s’étendent les grandes fabriques.
Parmi les très grandes fabriques qui emploient des centaines (et parfois
des milliers) d’ouvriers, on n’en trouvera guère une seule où il ne
se soit produit des grèves ouvrières. Quand les grandes fabriques
et usines étaient peu nombreuses en Russie, les grèves étaient également
peu nombreuses mais, depuis que les grandes fabriques se multiplient
rapidement, tant dans les vieilles localités industrielles que dans
des villes et bourgades nouvelles, les grèves se font de plus en plus
fréquentes. D’où vient que la grande production industrielle conduise
toujours à des grèves ? Cela vient de ce que le capitalisme conduit
nécessairement à la lutte des ouvriers contre les patrons et, quand
on passe au stade de la grande production, cette lutte affecte nécessairement
la forme de grèves.
Expliquons-nous.
On appelle capitalisme une organisation
de la société où la terre, les fabriques, l’outillage, etc., appartiennent
à un petit nombre de grands propriétaires fonciers et de capitalistes,
tandis que la masse du peuple ne possède rien ou presque rien en propre
et doit, par conséquent, chercher de l’embauche. Les grands propriétaires
fonciers et les patrons de fabrique embauchent les ouvriers et leur
font fabriquer tels ou tels produits qu’ils vendent sur le marché.
Ce faisant, les patrons se contentent de payer aux ouvriers un salaire
qui leur permet à peine de subsister avec leurs familles ; tout
ce que l’ouvrier produit au-delà de cette quantité de produits, le
patron l’empoche, cela constitue son profit. Ainsi, en régime d’économie
capitaliste, la masse du peuple effectue un travail salarié pour autrui,
elle travaille non pas pour elle-même mais pour des patrons contre
un salaire. On conçoit que les patrons s’efforcent toujours de diminuer
le salaire : moins ils donneront aux ouvriers, et plus il leur
restera de profit. Quant aux ouvriers, ils s’efforcent d’obtenir le
salaire le plus élevé possible, pour procurer à l’ensemble de leur
famille une nourriture saine et abondante, pour vivre dans un bon
logement, pour ne pas être vêtus de loques mais s’habiller comme tout
le monde. Ainsi, entre patrons et ouvriers, il y a lutte incessante
à propos du salaire : le patron est libre d’embaucher qui bon
lui semble, et il cherche l’ouvrier le moins cher. L’ouvrier est libre
de s’embaucher chez le patron de son choix, et il cherche le plus
cher, celui qui paie davantage. Que l’ouvrier travaille à la campagne
ou à la ville, qu’il s’embauche chez un grand propriétaire foncier,
un paysan riche, un entrepreneur ou dans une fabrique, il marchande
toujours avec le patron, il est aux prises avec lui au sujet de son
salaire.
Mais l’ouvrier isolé peut-il soutenir
cette lutte ? Le nombre des ouvriers s’accroît sans cesse :
les paysans ruinés désertent les campagnes et fuient vers les villes
et vers les fabriques. Les grands propriétaires fonciers et les patrons
de fabrique introduisent des machines, qui enlèvent le travail aux
ouvriers. Les chômeurs se multiplient dans les villes et les mendiants
dans les campagnes ; les affamés font de plus en plus baisser
les salaires. Il devient impossible à l’ouvrier de lutter isolément
contre le patron. Réclame-t-il un bon salaire ou refuse-t-il d’accepter
une réduction de sa paie, le patron lui répond : va-t’en d’ici,
il ne manque pas d’affamés à ma porte, qui seront trop heureux de
travailler même pour un bas salaire.
Quand la misère du peuple en arrive
au point que dans les villes et dans les campagnes il y a en permanence
des masses de chômeurs, que les propriétaires de fabrique accumulent
d’immenses richesses et que les petits patrons sont évincés par les
millionnaires, alors l’ouvrier isolé se trouve totalement impuissant
devant le capitaliste. Celui-ci peut l’écraser tout à fait, l’éreinter
jusqu’à ce que mort s’ensuive par un travail de forçat, et non seulement
lui mais aussi sa femme et ses enfants. En effet, prenez les branches
de production où les ouvriers n’ont pas encore obtenu la protection
de la loi et où ils ne peuvent opposer de résistance aux capitalistes :
vous y verrez une journée de travail démesurément longue, qui va jusqu’à
17 et 19 heures ; vous y verrez des enfants de 5 à 6 ans s’épuisant
à la tâche ; vous y verrez une génération d’ouvriers constamment
affamés et mourant peu à peu d’inanition. Exemple : les ouvriers
qui travaillent à domicile pour le compte des capitalistes ;
du reste, tout ouvrier évoquera encore quantité d’autres exemples !
Même à l’époque de l’esclavage et du servage les travailleurs n’ont
jamais connu une oppression aussi effroyable que celle que les capitalistes
parviennent à faire peser lorsque les ouvriers ne peuvent leur opposer
de résistance, lorsqu’ils ne peuvent arracher des lois limitant l’arbitraire
des patrons.
C’est pour ne pas se laisser réduire
à cette extrémité que les ouvriers engagent une lutte farouche. Voyant
qu’en agissant isolément, chacun d’eux est totalement impuissant et
risque de succomber sous le joug du capital, ils en viennent à se
dresser tous ensemble contre leurs patrons. Des grèves ouvrières éclatent.
Il arrive souvent qu’au début les ouvriers ne savent même pas ce qu’ils
veulent obtenir, qu’ils ne se rendent pas compte de ce qui les fait
agir ainsi : ils brisent les machines, sans plus, ou détruisent
les fabriques. Ils veulent seulement faire sentir aux patrons des
fabriques qu’ils sont révoltés, ils font l’essai de leurs forces conjuguées
pour sortir d’une situation intolérable, sans savoir encore au juste
pourquoi leur situation est si désespérée et vers quoi ils doivent
orienter leurs efforts.
Dans tous les pays, l’indignation ouvrière
s’est manifestée à l’origine par des soulèvements isolés — des émeutes,
comme disent chez nous les patrons et la police. Dans tous les pays,
ces soulèvements isolés ont engendré, d’une part, des grèves plus
ou moins pacifiques et, d’autre part, une lutte générale de la classe
ouvrière pour son émancipation.
Quel est le rôle des grèves (ou débrayages)
dans la lutte de la classe ouvrière ? Pour répondre à cette question,
nous devons d’abord nous arrêter un peu plus longuement sur les grèves.
Si, comme nous l’avons vu, le salaire de l’ouvrier est déterminé par
un contrat entre celui-ci et le patron et si en l’occurrence l’ouvrier
isolé se trouve totalement impuissant, il est évident que les ouvriers
doivent nécessairement soutenir en commun leurs revendications, qu’ils
doivent nécessairement organiser des grèves pour empêcher les patrons
de réduire les salaires ou pour obtenir un salaire plus élevé. Et,
en effet, il n’est pas un seul pays à régime capitaliste où il n’y
ait des grèves ouvrières. Dans tous les pays d’Europe et en Amérique,
les ouvriers se sentent partout impuissants quand ils agissent isolément,
et ils ne peuvent résister au patronat qu’en agissant tous ensemble,
soit en faisant grève, soit en en agitant la menace. Plus le capitalisme
se développe, plus les grandes usines et fabriques se multiplient
rapidement, plus les petits capitalistes sont évincés par les grands,
et plus devient impérieuse la nécessité d’une résistance commune des
ouvriers car le chômage s’aggrave, la concurrence devient plus âpre
entre les capitalistes qui s’efforcent de produire leurs marchandises
au plus bas prix possible (ce qui demande que les ouvriers soient
payés le moins cher possible), les fluctuations dans l’industrie s’accentuent
et les crises deviennent plus violentes [2].
Lorsque l’industrie prospère, les patrons de fabrique réalisent de
gros profits, sans songer le moins du monde à les partager avec les
ouvriers ; mais en période de crise ils cherchent à faire supporter
les pertes par les ouvriers. La nécessité des grèves dans la société
capitaliste est si bien reconnue par tout le monde dans les pays d’Europe
que la loi ne les y interdit pas, c’est seulement en Russie que subsistent
des lois barbares contre les grèves (nous reviendrons une autre fois
sur ces lois et leur application).
Mais les grèves, qui relèvent de la
nature même de la société capitaliste, marquent le début de la lutte
menée par la classe ouvrière contre cette organisation de la société.
Lorsque les riches capitalistes ont en face d’eux des ouvriers isolés
et nécessiteux, c’est pour ces derniers l’asservissement total. La
situation change quand ces ouvriers nécessiteux unissent leurs efforts.
Les patrons ne tireront aucun profit de leurs richesses s’ils ne trouvent
pas des ouvriers acceptant d’appliquer leur travail à l’outillage
et aux matières premières des capitalistes et de produire de nouvelles
richesses. Quand des ouvriers isolés ont affaire aux patrons, ils
restent de véritables esclaves voués à travailler éternellement au
profit d’autrui pour une bouchée de pain, à demeurer éternellement
des mercenaires dociles et muets. Mais, lorsqu’ils formulent en commun
leurs revendications et refusent d’obéir à ceux qui ont le sac bien
garni, ils cessent d’être des esclaves, ils deviennent des êtres humains,
ils commencent à exiger que leur travail ne serve plus seulement à
enrichir une poignée de parasites mais permette aux travailleurs de
vivre humainement. Les esclaves commencent à exiger de devenir des
maîtres, de travailler et de vivre non point au gré des grands propriétaires
fonciers et des capitalistes mais comme l’entendent les travailleurs
eux-mêmes. Si les grèves inspirent toujours une telle épouvante aux
capitalistes, c’est parce qu’elles commencent à ébranler leur domination.
« Tous les rouages s’arrêteront si ton bras puissant
le veut« , dit de la classe ouvrière une chanson des ouvriers allemands.
En effet : les fabriques, les usines, les grandes exploitations
foncières, les machines, les chemins de fer, etc., etc., sont pour
ainsi dire les rouages d’un immense mécanisme qui extrait des produits
de toutes sortes, leur fait subir les transformations nécessaires
et les livre à l’endroit voulu. Tout ce mécanisme est actionné par
l’ouvrier, qui cultive la terre, extrait le minerai, produit des marchandises
dans les fabriques, construit les maisons, les ateliers, les voies
ferrées. Quand les ouvriers refusent de travailler, tout ce mécanisme
menace de s’arrêter. Chaque grève rappelle aux capitalistes que ce
ne sont pas eux les vrais maîtres mais les ouvriers, qui proclament
de plus en plus hautement leurs droits. Chaque grève rappelle aux
ouvriers que leur situation n’est pas désespérée, qu’ils ne sont pas
seuls. Voyez quelle énorme influence la grève exerce aussi bien sur
les grévistes que sur les ouvriers des fabriques voisines ou situées
à proximité ou faisant partie d’une branche d’industrie similaire.
En temps ordinaire, en temps de paix, l’ouvrier traîne son boulet
sans mot dire, sans contredire le patron, sans réfléchir à sa situation.
En temps de grève, il formule bien haut ses revendications, il remet
en mémoire aux patrons toutes les contraintes tyranniques qu’ils lui
ont infligées, il proclame ses droits, il ne songe pas uniquement
à lui-même et à sa paie, il songe aussi à tous les camarades qui ont
cessé le travail en même temps que lui et qui défendent la cause ouvrière
sans craindre les privations. Toute grève entraîne pour l’ouvrier
une foule de privations, et de privations si effroyables qu’elles
ne peuvent se comparer qu’aux calamités de la guerre : la faim
au foyer, la perte du salaire, bien souvent l’arrestation, l’expulsion
de la ville qu’il habite de longue date et où il a son travail. Et
malgré toutes ces calamités, les ouvriers méprisent ceux qui lâchent
leurs camarades et qui composent avec le patron. Malgré les misères
causées par la grève, les ouvriers des fabriques voisines éprouvent
toujours un regain de courage en voyant leurs camarades engager la
lutte. « Ceux qui supportent tant de misères pour briser
la résistance d’un seul bourgeois sauront aussi briser la force de
la bourgeoisie tout Entière » [3],
a dit un des grands maîtres du socialisme, Engels, à propos des grèves
des ouvriers anglais. Il suffit souvent qu’une seule fabrique se mette
en grève pour que le mouvement gagne aussitôt une foule d’autres fabriques.
Tant est grande l’influence morale des grèves, tant est contagieux
pour les ouvriers le spectacle de leurs camarades qui, fût-ce momentanément,
cessent d’être des esclaves pour devenir les égaux des riches !
Toute grève contribue puissamment à amener les ouvriers à l’idée du
socialisme, de la lutte de la classe ouvrière tout entière pour s’affranchir
du joug du capital. Il est arrivé très souvent qu’avant une grève
importante les ouvriers d’une fabrique, d’une industrie, d’une ville
donnée ne sachent presque rien du socialisme et n’y pensent guère
et qu’après la grève les cercles et les associations se multiplient
parmi eux, tandis qu’un nombre sans cesse grandissant d’ouvriers devenaient
socialistes.
La grève apprend aux ouvriers à comprendre
ce qui fait la force des patrons et ce qui fait la force des ouvriers,
elle leur apprend à penser non pas seulement à leur propre patron
et à leurs camarades les plus proches mais à tous les patrons, à toute
la classe des capitalistes et à toute la classe ouvrière. Lorsqu’un
patron de fabrique, qui a amassé des millions grâce au labeur de plusieurs
générations d’ouvriers, refuse la moindre augmentation de salaire
ou tente même de le réduire encore plus et, en cas de résistance,
jette sur le pavé des milliers de familles affamées, les ouvriers
voient clairement que la classe capitaliste dans son ensemble est
l’ennemie de la classe ouvrière dans son ensemble, qu’ils ne peuvent
compter que sur eux-mêmes et leur union. Il arrive très souvent que
le patron s’emploie le plus possible à tromper les ouvriers, à se
faire passer pour leur bienfaiteur, à dissimuler son exploitation
des ouvriers par une aumône dérisoire, par des promesses fallacieuses.
Chaque grève détruit toujours, d’un coup, tout ce mensonge, elle montre
aux ouvriers que leur « bienfaiteur » est un loup déguisé en mouton.
Mais la grève n’ouvre pas seulement
les yeux des ouvriers en ce qui concerne les capitalistes, elle les
éclaire aussi sur le gouvernement et sur les lois. De même que les
patrons de fabrique s’efforcent de se faire passer pour les bienfaiteurs
des ouvriers, les fonctionnaires et leurs valets s’efforcent de persuader
ces derniers que le tsar et son gouvernement agissent en toute équité,
avec un égal souci du sort des patrons et de celui des ouvriers. L’ouvrier
ne connaît pas les lois, il n’a pas affaire aux fonctionnaires, surtout
à ceux d’un rang supérieur, et c’est pourquoi il ajoute souvent foi
à tout cela. Mais voilà qu’éclate une grève. Procureur, inspecteur
de fabrique, police, souvent même la troupe se présentent à la fabrique.
Les ouvriers apprennent qu’ils ont contrevenu à la loi : la loi
autorise les patrons à se réunir et à discuter ouvertement des moyens
de réduire les salaires des ouvriers mais elle fait un crime à ces
ouvriers de se concerter en vue d’une action commune ! Ils sont
expulsés de leurs logements ; la police ferme les boutiques où
ils pourraient acheter des vivres à crédit ; on cherche à dresser
les soldats contre les ouvriers, même quand ceux-ci restent bien calmes
et pacifiques. On va jusqu’à faire tirer sur les ouvriers et, lorsque
les soldats massacrent des ouvriers désarmés en tirant dans le dos
de ceux qui s’enfuient, le tsar en personne adresse ses remerciements
à la troupe (c’est ainsi que le tsar a remercié les soldats qui avaient
tué des ouvriers en grève à Iaroslavl, en 1895). Chaque ouvrier se
rend compte alors que le gouvernement du tsar est son pire ennemi,
qu’il défend les capitalistes et tient les ouvriers pieds et poings
liés. L’ouvrier commence à se rendre compte que les lois sont faites
dans l’intérêt exclusif des riches, que les fonctionnaires aussi défendent
l’intérêt de ces derniers, que la classe ouvrière est bâillonnée et
qu’on ne lui laisse pas même la possibilité de faire connaître ses
besoins, que la classe ouvrière doit de toute nécessité conquérir
le droit de grève, le droit de publier des journaux ouvriers, le droit
de participer à la représentation nationale, laquelle doit promulguer
les lois et veiller à leur application. Et le gouvernement comprend
fort bien lui-même que les grèves dessillent les yeux des ouvriers,
c’est pourquoi il les craint tant et s’efforce à tout prix de les
étouffer le plus vite possible. Ce n’est pas sans raison qu’un ministre
de l’Intérieur allemand [4],
qui s’est rendu particulièrement célèbre en persécutant avec férocité
les socialistes et les ouvriers conscients, a déclaré un jour devant
les représentants du peuple : « Derrière chaque grève se profile
l’hydre [le monstre] de la révolution » ; chaque grève affermit
et développe chez les ouvriers la conscience du fait que le gouvernement
est son ennemi, que la classe ouvrière doit se préparer à lutter contre
lui pour les droits du peuple.
Ainsi les grèves apprennent aux ouvriers
à s’unir ; elles leur montrent que c’est seulement en unissant
leurs efforts qu’ils peuvent lutter contre les capitalistes ;
les grèves apprennent aux ouvriers à penser à la lutte de toute la
classe ouvrière contre toute la classe des patrons de fabrique et
contre le gouvernement autocratique, le gouvernement policier. C’est
pour cette raison que les socialistes appellent les grèves « l’école
de guerre », une école où les ouvriers apprennent à faire la guerre
à leurs ennemis, afin d’affranchir l’ensemble du peuple et tous les
travailleurs du joug des fonctionnaires et du capital.
Mais « l’école de guerre« ,
ce n’est pas encore la guerre elle-même. Lorsque les grèves se propagent
largement parmi les ouvriers, certains d’entre eux (et quelques socialistes)
en viennent à s’imaginer que la classe ouvrière peut se borner à faire
grève, à organiser des caisses et des associations pour les grèves,
et que ces dernières à elles seules suffisent à la classe ouvrière
pour arracher une amélioration sérieuse de sa situation, voire son
émancipation. Voyant la force que représentent l’union des ouvriers
et leurs grèves, même de faible envergure, certains pensent qu’il
suffirait aux ouvriers d’organiser une grève générale s’étendant à
l’ensemble du pays pour obtenir des capitalistes et du gouvernement
tout ce qu’ils désirent. Cette opinion a été également celle d’ouvriers
d’autres pays, lorsque le mouvement ouvrier n’en était qu’à ses débuts
et manquait tout à fait d’expérience. Mais cette opinion
est fausse. Les grèves sont un des moyens
de lutte de la classe ouvrière pour son affranchissement mais non
le seul ; et si les ouvriers ne portent pas leur attention sur
les autres moyens de lutte, ils ralentiront par là la croissance et
les progrès de la classe ouvrière. En effet, pour assurer le succès
des grèves, il faut des caisses afin de faire vivre les ouvriers pendant
la durée du mouvement. Ces caisses, les ouvriers en organisent dans
tous les pays (généralement dans le cadre d’une industrie donnée,
d’une profession ou d’un atelier) ; mais chez nous, en Russie,
la chose est extrêmement difficile car la police les traque, confisque
l’argent et emprisonne les ouvriers. Il va de soi que les ouvriers
savent aussi déjouer la police, que la création de ces caisses est
utile et nous n’entendons pas la déconseiller aux ouvriers. Mais on
ne peut espérer que ces caisses ouvrières, interdites par la loi,
puissent attirer beaucoup de membres ; or, avec un nombre restreint
d’adhérents, elles ne seront pas d’une très grande utilité. Ensuite,
même dans les pays où les associations ouvrières existent librement
et disposent de fonds très importants, même dans ces pays la classe
ouvrière ne saurait se borner à lutter uniquement par des grèves.
Il suffit d’un arrêt des affaires dans l’industrie (d’une crise comme
celle qui se dessine actuellement en Russie) pour que les patrons
des fabriques provoquent eux-mêmes des grèves, parce qu’ils ont parfois
intérêt à faire cesser momentanément le travail, à ruiner les caisses
ouvrières. Aussi les ouvriers ne peuvent-ils se borner exclusivement
aux grèves et aux formes d’organisation qu’elles impliquent. En deuxième
lieu, les grèves n’aboutissent que là où les ouvriers sont déjà assez
conscients, où ils savent choisir le moment propice, formuler leurs
revendications, où ils sont en liaison avec les socialistes pour se
procurer ainsi des tracts et des brochures. Or ces ouvriers sont encore
peu nombreux en Russie et il est indispensable de tout faire pour
en augmenter le nombre, pour initier la masse des ouvriers à la cause
ouvrière, pour les initier au socialisme et à la lutte ouvrière. Cette
tâche doit être assumée en commun par les socialistes et les ouvriers
conscients, qui forment à cet effet un parti ouvrier socialiste. En
troisième lieu, les grèves montrent aux ouvriers, nous l’avons vu,
que le gouvernement est leur ennemi, qu’il faut lutter contre lui.
Et, dans tous les pays, les grèves ont en effet appris progressivement
à la classe ouvrière à lutter contre les gouvernements pour les droits
des ouvriers et du peuple tout entier. Ainsi que nous venons de le
dire, seul un parti ouvrier socialiste peut mener cette lutte, en
diffusant parmi les ouvriers des notions justes sur le gouvernement
et sur la cause ouvrière. Nous parlerons plus spécialement une autre
fois de la façon dont les grèves sont menées chez nous, en Russie,
et de l’usage que doivent en faire les ouvriers conscients. Pour le
moment, il nous faut souligner que les grèves, comme on l’a dit ci-dessus,
sont « l’école de guerre » et non la guerre elle-même,
qu’elles sont seulement un des moyens de la lutte, une des formes
du mouvement ouvrier. Des grèves isolées les ouvriers peuvent et doivent
passer et passent effectivement dans tous les pays à la lutte de la
classe ouvrière tout entière pour l’émancipation de tous les travailleurs.
Lorsque tous les ouvriers conscients deviennent des socialistes, c’est-à-dire
aspirent à cette émancipation, lorsqu’ils s’unissent à travers tout
le pays pour propager le socialisme parmi les ouvriers, pour enseigner
aux ouvriers tous les procédés de lutte contre leurs ennemis, lorsqu’ils
forment un parti ouvrier socialiste luttant pour libérer tout le peuple
du joug du gouvernement et pour libérer tous les travailleurs du joug
du capital, alors seulement la classe ouvrière adhère sans réserve
au grand mouvement des ouvriers de tous les pays, qui rassemble tous
les ouvriers et arbore le drapeau rouge avec ces mots : « Prolétaires
de tous les pays, unissez-vous !«
[1]
L’article « A propos des grèves » a été écrit à
la fin de 1899 par Lénine, alors en relégation en Sibérie, pour la
Rabotchaïa Gazéta. L’article devait avoir trois
parties, comme Lénine l’indique dans son préambule. On ne possède
que la première partie, recopiée de la main de N. K. Kroupskaïa, et
on n’a pu établir si les deux autres parties avaient été rédigées.
(N. Ed.)
[2]
Des crises dans l’industrie et de leur signification pour les ouvriers
nous parlerons plus en détail une autre fois. Pour l’instant, nous
nous bornerons à faire remarquer que ces dernières années les affaires
ont très bien marché pour l’industrie russe, elle a « prospéré » ;
mais aujourd’hui (fin 1899) des symptômes évidents montrent que cette
« prospérité » va aboutir à une crise : à des difficultés dans
l’écoulement des marchandises, à des faillites de propriétaires de
fabrique, à la ruine des petits patrons et à des calamités terribles
pour les ouvriers (chômage, réduction des salaires, etc.). (Note de
Lénine).
[3]
F. Engels, La situation de la classe laborieuse en
Angleterre, Editions Sociales, Paris, 1975, p. 281. (N. Ed.)
[4]
Il s’agit du ministre de l’Intérieur prussien, von Puttkamer. (N.
Ed.)
V.I. Lénine